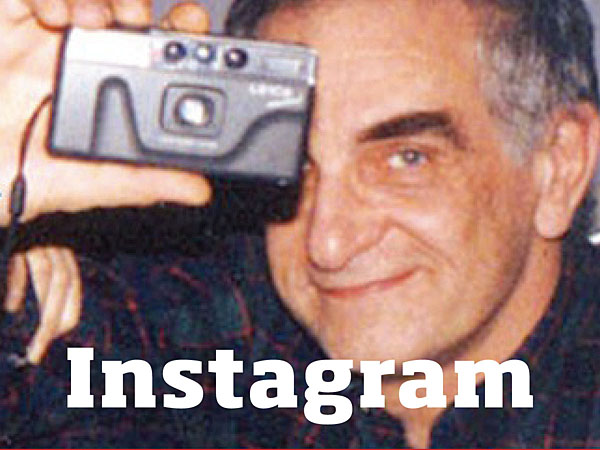Dekalog (1988-1989)
Le Décalogue de Kieślowski l'a révélé au Festival de Cannes en 1988, puis au monde entier, avec la projection de Tu ne tueras point, version cinéma du cinquième épisode. Le Décalogue [Dekalog] fut ensuite projeté à Cannes et à Venise en 1989 ; pourtant, le cycle n'aurait dû être qu'une série de dix épisodes, pour la télévision polonaise (il fut finalement diffusé en décembre de la même année, un mois après la chute du Mur de Berlin). Une série pas ordinaire, qui a marqué l'histoire du cinéma.

10 clés pour (commencer à) comprendre le Décalogue de Kieślowski

Le message du Décalogue, selon Kieślowski
«[…] vivez avec précaution, regardez autour de vous, prenez garde à ce que vos actions ne causent pas de préjudice aux autres, ne les blessez pas ou ne leur causez pas de douleur… » Ainsi s’exprime Kieślowski en 1988 (1), qui tente de résumer le message du Décalogue. Cinéaste polonais de l’Inquiétude morale, toutes ses grandes fictions mettent en avant la responsabilité individuelle et le Décalogue ré-interprète les Dix Commandements en pointant les conflits moraux d’une poignée d’habitants d’une cité de Varsovie.

Deux (ou trois) personnages centraux
Chaque épisode s’articule autour d’un duo de personnages : le père et la fille dans le 4, Tomek et Magda dans le 6. Associés parfois un troisième protagoniste (la tante du 1 ou l’amant du 9). Le Décalogue, ce sont avant tout des drames intimes, des fêlures. Et des figures que l’on est pas prêt d’oublier.

Krzysztof, Krzysztof et Zbigniew
Kieślowski rencontre en 1984 Krzysztof Piesiewicz, avocat, pour le tournage d’un projet de documentaire abandonné, avant d’écrire ensemble le scénario d’une fiction: Sans Fin. Le musicien Zbigniew Preisner les rejoint. Les trois hommes collaboreront à Dekalog. Au total sur 17 films, de Sans Fin aux Trois couleurs : Bleu, Blanc, Rouge.

Tout Varsovie, toute une époque
Dariusz Jabłonski, premier assistant sur le Décalogue, se souvient qu’il n’y a pas un quartier de Varsovie qui n’ait été utilisé pour le film. Tout cela dans les conditions matérielles difficiles du cinéma de la République populaire de Pologne (les immeubles sont des bâtiments HLM du nord de Varsovie). Le Mur ne tombera qu’en 1989 et le Décalogue est chargé de cette atmosphère particulière, plombée : “on avait l’impression que cela ne s’arrêterait jamais”, racontent souvent les Polonais qui ont connu cette époque.

Deux épisodes en long-métrage
Pour financer la série, Krzysztof Kieślowski propose au ministère de la Culture (qui produit et censure le cinéma) de tourner deux longs-métrages supplémentaires : Tu ne tueras point (d’après le 5), pour la moitié du budget normal, et un autre film au même coût : « Ils ont choisi Brève histoire d’amour (le 6) », explique-t-il (2).

Les personnages féminins s’affirment
Encore discrets, conventionnels dans ses fictions, les personnages féminins de Kieślowski s’étoffent à partir de Sans Fin, réalisé avant le Décalogue. La série nous offre quelques beaux portraits : la libre Magda (6), Dorota et son problème de conscience (2), la volontaire Hanka (9) ou encore Zofia (7) ou la tante attentive du 1.

Le mystère du quotidien
Kieślowski est très attentif aux imperceptibles signes d’étrangeté du quotidien : une lumière qui s’éteint, un objet déplacé. Il met aussi en scène des hasards, jusqu’à en faire le sujet et le titre de son film Przypadek – Le Hasard, justement–, et des croisements de personnages. A l’image de la Comédie humaine balzacienne, le héros d’un épisode croise parfois, sans le voir, celui d’un autre.

Le Décalogue en terre catholique
Malgré le pouvoir socialiste en place, l’église polonaise reste puissante (en souterrain) et les catholiques représentent plus des 9/10e de la population. Réaliser le Décalogue, même affranchi des Dix Commandements, n’est pas anodin. Et puis il y a la Foi, que Kieślowski aimerait peut-être posséder. Il se fabrique un Dieu à lui : il s’interroge, il doute beaucoup et toujours…

Neuf chefs opérateurs
Le Décalogue devait être commandé à dix jeunes réalisateurs, pilotés par Kieślowski qui, emballé par le projet, reprend à son compte l’ensemble de la mise en scène. Par contre, il utilise neuf chefs op’ différents (Sobociński tourne deux épisodes), pour varier la photo. à l’époque, on a coutume de dire qu’il y a deux catégories d’acteurs : ceux qui tournent dans le Décalogue… et les autres.

« Une série ! »
C’est par ces mots que s’achève le 10. Une exclamation burlesque des deux frères qui avaient hérité d’une fortune qu’on vient de leur subtiliser. Et un clin d’œil à la série télévisée que constitue le Décalogue, diffusé en Pologne en décembre 1989.
Les dix épisodes du Décalogue et leur version cinéma :
- Dekalog Jeden | Décalogue 1
- Dekalog Dwa | Décalogue 2
- Dekalog Trzy | Décalogue 3
- Dekalog Cztery | Décalogue 4
- Dekalog Pięć | Décalogue 5
- Dekalog Sześć | Décalogue 6
- Dekalog Siedem | Décalogue 7
- Dekalog Ociem | Décalogue 8
- Dekalog Dziewięć | Décalogue 9
- Dekalog Dziesięć | Décalogue 10
- Krótki film o zabijaniu | Tu ne Tueras point (version cinéma du Décalogue 5)
- Krótki film o miłości | Brève histoire d'Amour (version cinéma du Décalogue 6)
Kieślowski, encore plus loin, pour en savoir plus sur le Décalogue
Dans le livre, retrouvez des commentaires et témoignages (comédiens, chefs opérateurs, monteuse, assistants, etc.) sur chaque épisode, illustrés de photos des principaux lieux de tournages, d'une carte commentée de Varsovie, etc. Le scénario condensé est présenté comparé à la version filmée ainsi qu'aux deux versions long-métrage : Tu ne tueras point (Dekalog 5) et Brève histoire d'amour (Dekalog 6).